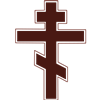Semaine d’études liturgiques 2026 : appel à exposés
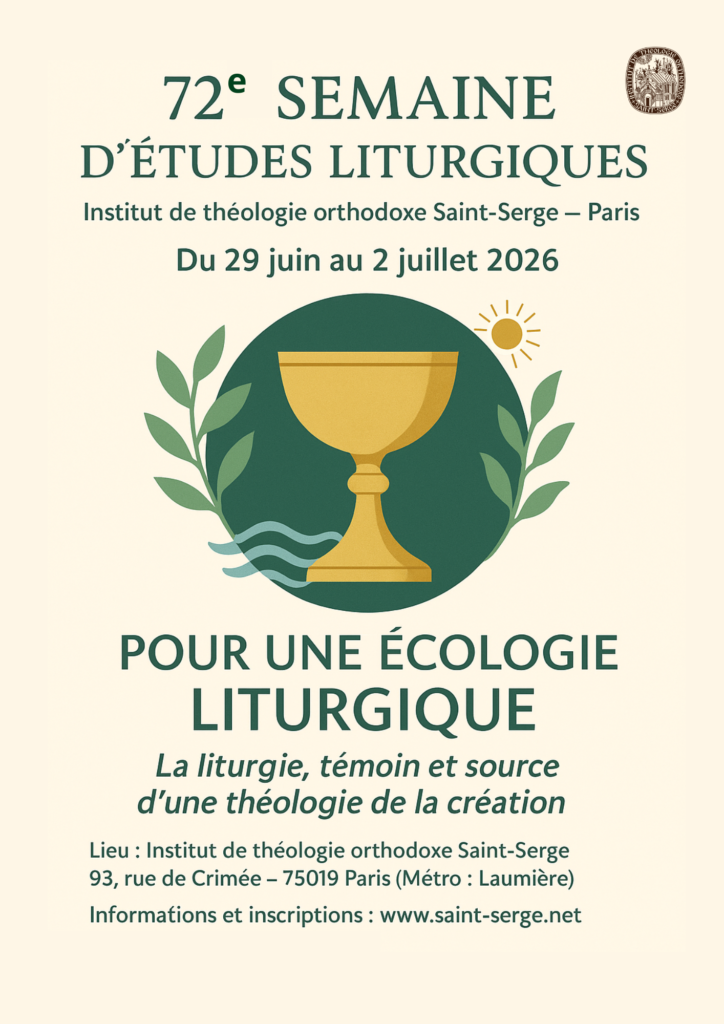
Chères et chers amis et collègues liturgistes,
Vous êtes cordialement invités à participer à la prochaine Semaine d’Études liturgiques, 72e édition.
Thème retenu : Pour une écologie liturgique. La liturgie, témoin et source d’une théologie de la création
La rencontre se déroulera du lundi 29 juin après-midi au jeudi 2 juillet 2026 après-midi dans les locaux de l’Institut Saint-Serge à Paris.
Face à une réduction fréquente des questions écologiques à des débats idéologiques, susceptibles de subordonner la préservation de la planète à des causes plus politiciennes ou identitaires, ou encore à une approche relevant de la seule morale, on se propose d’examiner ce que les traditions chrétiennes liturgiques annoncent sur le monde créé, sachant que le Mystère du salut ne doit pas être compris comme visant uniquement l’être humain, au détriment de la matière qui l’environne. Mais le monde, fait de matière, est appelé lui aussi à une transfiguration, ce dont se font les témoins de nombreuses formules dans la plupart, sinon dans toutes les familles liturgiques, ainsi que dans des écrits patristiques et hagiographiques. De cette place positive de la matière dans le projet divin (cf. Gen 1,12) peut découler aujourd’hui une approche saine de l’écologie, au-delà de toute réduction propre à ce monde : telle est l’approche que les organisateurs proposent pour le colloque liturgique prévu à Saint-Serge en été 2026.
PRINCIPAUX AXES THÉMATIQUES : du thème de la création à celui de l’écologie
- Quel plan divin pour la création ? (Gen 1-2 et autres occurrences bibliques) ; le salut de l’être humain et celui du monde.
- Que disent de ce plan les divers formulaires et traditions liturgiques ? Leur adéquation ou non avec des écrits patristiques ou hagiographiques (homélies, vies de saints), et avec des représentations visuelles (fresques, mosaïques, vitraux, …) ; la place de la matière dans le Mystère du salut.
- L’écologie comme mise en œuvre de ce plan divin : sa place dans les liturgies.
EXPOSÉS ou EXEMPLES POSSIBLES :
Certains contacts ont déjà été pris en vue d’exposés introductifs et généraux, avec un accord de principe des orateurs pressentis, mais cette réflexion doit être prolongée, soit avec d’autres exposés de fond, soit avec des exemples d’aspects recelés dans des traditions particulières d’hier et d’aujourd’hui. Voici une liste non exhaustive d’aspects possibles à traiter :
-Saint Irénée et autres pères, sur le thème de la récapitulation, une réalité qui concerne l’être humain, mais qui inclut aussi l’univers qui l’entoure ;
-La vocation de l’environnement : comprise comme un retour de la création à sa plénitude et à son harmonie retrouvées avec le Créateur, par la médiation de Jésus-Christ ; cette vocation est actualisée par la liturgie ;
– projet d’introduction d’une Fête du Dieu Créateur : le message écologique de cette solennité ;
– la place de la création dans des traditions homilétiques et euchologiques ;
-manifestations paradisiaques dans les vies des saints : parmi d’autres exemples hagiographiques possibles : le cas du transfert des reliques de St Martin de Tours, accompagné d’un refleurissement des plantes sur le trajet ;
-la Messe sur le monde et l’approche du p. Pierre Teilhard de Chardin ;
-exemples iconographiques : études possibles de vitraux, fresques, peintures, mosaïques représentant la création transfigurée : St Marc de Venise, Ste Pudence et St Clément à Rome, vitraux de la cathédrale de Chartres, parmi d’autres exemples anciens ou plus récents, possibles à étudier ;
– …
- Méthode d’approche et délimitations
Les auteurs d’exposés devront particulièrement veiller à respecter les critères ci-dessous, déterminants pour qu’un projet soit retenu, qu’il s’agisse de l’exposé oral ou du texte écrit à suivre :
– la nouveauté et l’originalité de la problématique proposée,
– la relation du projet avec le thème général retenu cette année ;
– les sources : qualité de leur référencement et précision de leur analyse ;
– la qualité de la démarche historique ;
– la qualité de l’argumentation théologique, car c’est l’intention finale de la démarche d’investigation scientifique et documentaire proposée.
- Modalités pratiques
Les orateurs intéressés sont priés de bien vouloir faire parvenir avant le 15 novembre 2025 un projet d’exposé à cette adresse : <semlit.stserge@yahoo.fr>. Pour pouvoir être examiné et retenu par les organisateurs, tout projet devra inclure :
– nom, prénom, adresses électronique et postale de l’intervenant,
– un titre provisoire, en précisant la langue dans laquelle sera prononcé l’exposé (voir ci-dessous les langues admises),
– 5 à 10 lignes d’argumentation,
– quelques éléments bio- et bibliographiques de l’auteur (activités académiques, engagement ecclésial, …, principaux titres de publications), à actualiser même en cas d’interventions récentes à Saint Serge, car nous n’archivons pas ces données, en constante évolution.
Une réponse de l’équipe d’organisation parviendra aux concernés peu après la date limite ci-dessus.
La durée des exposés est fixée à 25 minutes, suivies aussitôt d’un bref temps de questions de compréhension, puis d’un moment d’échanges et débats, regroupant quelques autres exposés thématiquement proches. Les langues dominantes de nos Colloques sont le français et l’anglais, cette année sans traduction assurée. En cas d’intervention en anglais, l’orateur est prié de distribuer un résumé en français, pour qu’un plus grand nombre d’auditeurs puisse suivre son propos. L’emploi d’une autre langue que le français ou l’anglais peut être aussi admis, mais sur entente explicite.
Une transmission des exposés à distance est possible pour les orateurs éloignés et empêchés de se déplacer jusqu’à Paris, bien qu’une participation sur place soit vivement souhaitée pour la durée de la rencontre, en faveur d’une meilleure qualité des échanges.
La situation matérielle de l’Institut organisateur ne lui permet malheureusement pas d’offrir une aide financière aux intervenants : les orateurs doivent se déplacer et se loger à leurs propres frais, et s’acquitter du montant de leur participation au colloque et de leurs repas, sauf le jour de leur exposé où le repas leur est offert. Toutefois, en cas de difficulté, à signaler clairement aux organisateurs, une aide partielle aux frais de transport, d’hébergement ou d’inscription demeure possible pour quelques intervenants parmi les plus démunis.
- Publication des textes
Un exposé retenu pour le colloque ne sera pas automatiquement publié dans les Actes, mais les membres du Comité éditorial se réservent le droit d’en évaluer ensuite la teneur scientifique, pour demander aux auteurs des amendements, le cas échéant. La présentation orale d’un exposé sans intention explicite de publication n’est pas admise.
Les modalités pratiques d’envoi des textes, la feuille de style et d’autres indications pratiques seront communiquées aux orateurs lors du colloque. Chaque publication devra être impérativement corrigée par un native speaker de la langue choisie.
Enfin, tous les orateurs sont priés de faire parvenir un texte provisoire de leur version orale avant le 1er juin 2026, de manière à exprimer auprès de l’équipe d’organisation leur engagement à participer à la rencontre et à publier leur texte une fois mis au point.
Nous restons à votre disposition pour renseignements complémentaires si besoin.
Dans l’attente de vos nouvelles, avec nos cordiales salutations,
Les membres de l’équipe de préparation des Semaines liturgiques Saint Serge.